ONGiste
Au bout d’une piste, une vallée s’offrait, éblouissante de lumière, comme la porte d’un monde d’esprits malins et d’oiseaux maléfiques. Nous étions éblouis et inquiets par ce prodige. La plaine s’étalait avec sensualité, féconde, étroite et douce. Prise individuellement, chaque parcelle du paysage était chaotique, parfois ravinée par la pluie. Mais l’ensemble dégageait une paix infinie que l’on aurait dit sortie d’un songe. Le village de Talung se blottissait à l’ombre des manguiers et des bananiers, sous la violence du soleil. Le vieil argent du fleuve Son Bang Giang, apaisé ou déchaîné selon la saison, roulait ses eaux vers la Chine. J’aurais contemplé des heures les rizières en damier, semblables à des miroirs ternis, les hommes et les femmes trottinant sur les digues ou les coureurs de piste, au loin, surgissant de la jungle comme des colonnes de fourmis. Talung apportait la réponse qui m’obsédait depuis Buchenwald : comment être heureux malgré tout ?
Après avoir connu l’humiliation de chaque jour en déportation, je m’étais fondu avec bonheur dans la politesse du Vietnam, qui n’est pas un attendrissement, mais une manière de préserver l’humanité en soi.
Ma vie à Talung fut une sorte de métaphore de mon destin, où le pire et le meilleur se sont imbriqués. Il arrive que certains instants contiennent en réduction toute une vie.
Le soir, je sortais du poste pour me promener dans le village tout proche. Des étals de soupe pho étaient dressés, comme partout au Vietnam. C’est là que les Tho, accroupis, touillaient leur nourriture et ressassaient leurs sentiments en parlant interminablement. Des paillotes étaient éclairées par des lampes à pétrole. La lune se perdait entre la rizière et le fleuve. C’était la paix. Mais pour combien de temps encore ?
L’homme qui commandait à mes côtés s’appelait Tran. Véritable chat sauvage, audacieux, il avait été salement atteint lors d’un accrochage. Avec précaution, nous l’avons brancardé vers le poste. Il ne criait pas. Il nous regardait, mais nous sentions qu’il était déjà ailleurs. Je me suis approché du brancard, fabriqué à coups de hache avec deux troncs d’arbres et des lanières de plantes. J’ai pris sa main, que j’ai serrée. Il n’a pas voulu me lâcher. Son regard était brûlant. Il ne quittait pas le mien. Combien de temps sommes-nous restés ainsi ? Je ne saurais le dire. A un moment, ses pupilles sont devenues fixes. Sa main est retombée sur le bois. J’ai fait signe aux porteurs de s’arrêter. Tran était mort. Le sang a reflué dans mes veines. J’ai fermé ses yeux.
Un jour de février 1950, j’ai vu arriver un convoi à moitié vide accompagné d’une escorte. J’ai cru à une inspection. C’était une opération de repli. La victoire communiste en Chine, sur l’autre rive du fleuve, avait changé le donne. Il fallait rapatrier toutes les forces éparpillées en Haute Région. D’un jour à l’autre, le poste de Talung risquait d’être submergé par le Vietminh, appuyé par les troupes de Mao. Il fallait faire vite, très vite, pour éviter une embuscade au retour. Les ordres n’étaient pas discutables. Il fallait obéir immédiatement.
Je suis resté quelques minutes avec les légionnaires pour assurer l’arrière-garde, en cas d’attaque vietminh, puis nous avons embarqué. A ce moment, j’ai vu ceux que je n’avais pas voulu voir, auxquels je n’avais pas voulu penser. Les habitants des villages environnants, prévenus par la rumeur, accouraient pour partir avec nous. Ils avaient accepté notre protection. Certains avaient servi de relais. Ils savaient que, sans nous, la mort était promise. Nous ne pouvions pas les embarquer, faute de place, et les ordres étaient formels : seuls les partisans pouvaient nous accompagner.
Les images de cet instant-là sont restées gravées dans ma mémoire, comme si elles avaient été découpées au fer, comme un remords qui ne s’atténuera jamais. Des hommes et des femmes qui m’avaient fait confiance, que j’avais entraînés à notre suite et que les légionnaires repoussaient sur le sol. Les mains qui s’accrochaient aux ridelles recevaient des coups de crosse jusqu’à tomber dans la poussière. Certains criaient, suppliaient. D’autres nous regardaient simplement, et leur incompréhension rendait notre trahison plus effroyable encore.
Cette scène de cauchemar, où tous les liens humains basculèrent dans l’innommable, me happe encore, certains soirs, pour me jeter dans les gouffres de mon passé. Le remords me hante alors que j’ai atteint, vaille que vaille, les hauts plateaux de la vie, cette période de paix où l’on adhère à soi-même. La guerre a détruit, en une seule journée, le miracle qui s’était épanoui sous son aile, fragile, insensé, illusoire. Les hommes et les femmes de Talung, les légionnaires et moi, avons été réduits à notre état naturel de brindilles dans le vent de l’Histoire. La vallée s’y attendait sans doute, avec sa mémoire qui remontait loin.
Pendant des années les cauchemars liés à l’évacuation de Talung ont rejoint ceux de la déportation. J’avais le sentiment d’avoir été parjure. Ce mot veut-il dire encore quelque chose à une époque où la notion d’honneur est passée à l’arrière-plan ? Disons qu’il ne s’agissait pas d’un serment chevaleresque. Tout simplement de centaines d’hommes et de femmes dont, parfois, les moindres traits sont inscrits dans ma mémoire et à qui, au nom du pays, j’avais demandé un engagement au péril de leur vie. Nous les avons abandonnés en deux heures. Nous avons pris la fuite comme des malfrats. Ils ont été assassinés à cause de nous.
Sachez-le, c’était un crime.
Toute une vie de Helie de Saint Marc


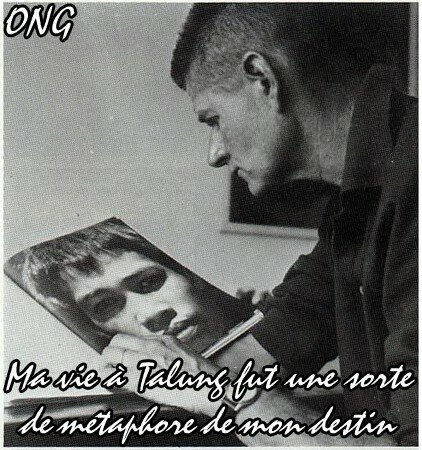

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F49%2F90%2F420656%2F99180705_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F86%2F56%2F420656%2F99042851_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F22%2F420656%2F98883178_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F76%2F25%2F420656%2F99019733_o.jpg)